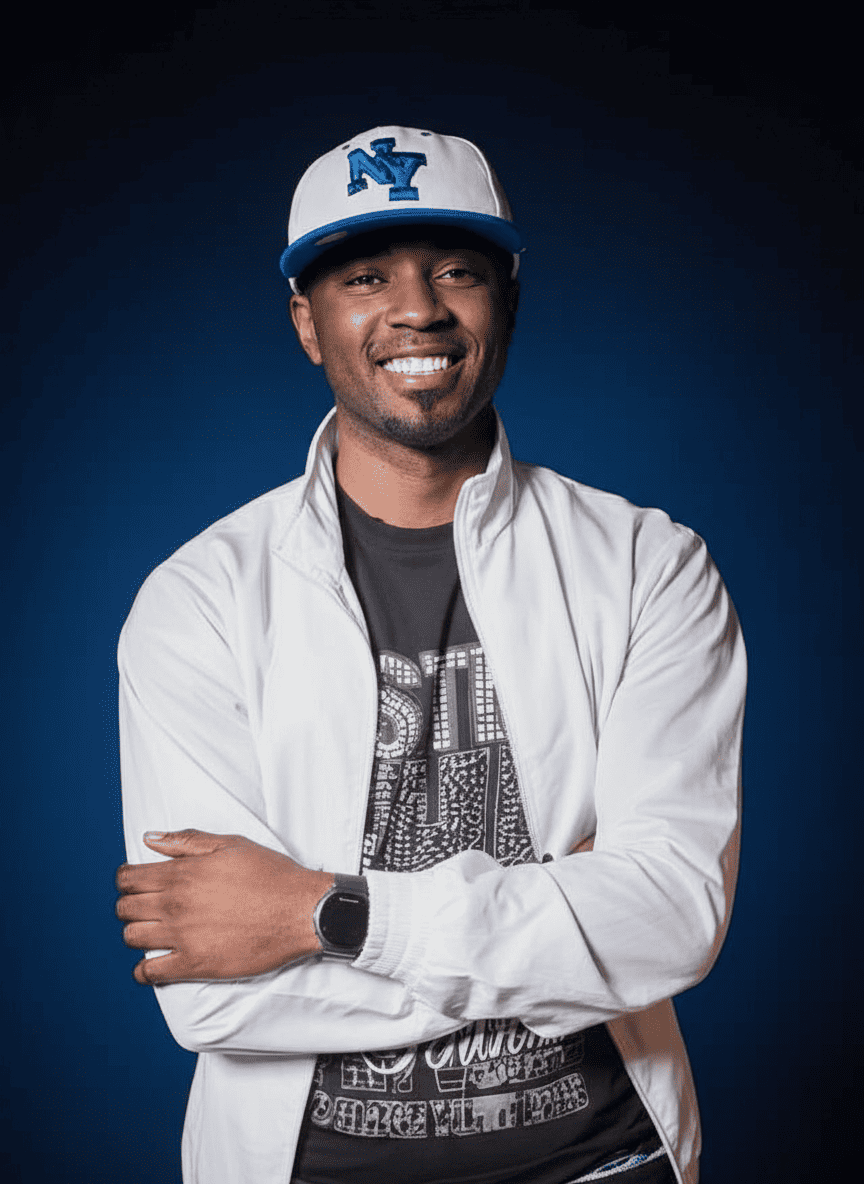Comment élaborer une bonne structure d’un article scientifique ?
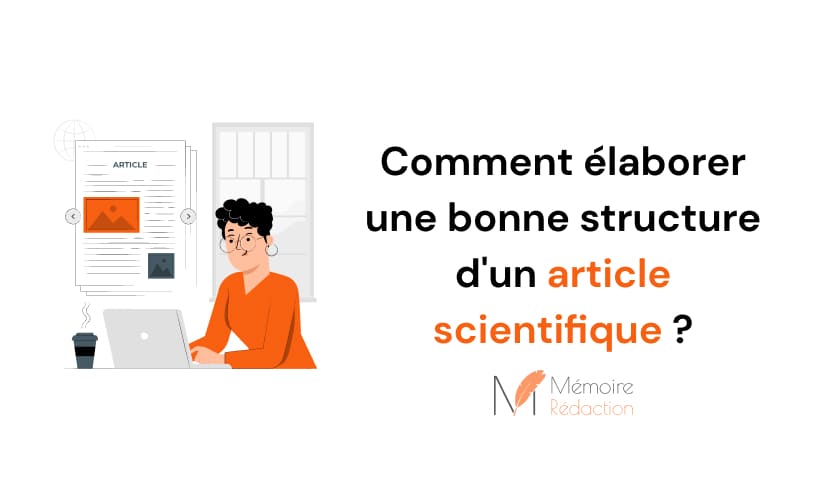
Table des matières
La rédaction d’un article scientifique est loin d’être une tâche facile. En effet, l’écriture de ce type de d’article obéit à des canons précis qu’il est important de respecter. Il ne suffit pas d’avoir simplement des compétences intellectuelles et techniques. Entre autres, il faut mener des recherches minutieuses, faire des analyses pertinentes, etc. Par ailleurs, il faut comprendre que la structure de l’article scientifique est particulière et mérite d’être respectée à la lettre.
De manière simple, un article scientifique est un travail de recherche mené et publié par un chercheur dans des revues scientifiques. C’est un travail dans lequel la personne se penche sur une question spécifique de son domaine d’études. En le faisant, celle-ci partage ses connaissances, son expertise avec ses pairs et les érudits de son domaine. En d’autres termes, la rédaction de l’article scientifique est un moyen d’enrichir les connaissances dans une discipline donnée. Il existe plusieurs types d’articles scientifiques à savoir :
- La note de recherche : elle est considérée comme un préalable ou encore un préliminaire à un article ou travail de recherche plus complet.
- L’article de recherche : il permet au chercheur de présenter les résultats originaux de ses recherches.
- L’article de synthèse : il permet quant à lui de faire une synthèse bibliographique sur un sujet donné.
Lors de sa rédaction, il est important de respecter scrupuleusement le plan de l’article scientifique.
Avant de commencer l’écriture d’un article scientifique, il est important d’élaborer au préalable un plan ou une structure. L’objectif de cette structuration est d’ordonner le contenu, afin de le rendre plus compréhensible par le lecteur. Il est extrêmement important d’avoir une belle cohérence entre les différentes parties. Le lecteur doit pouvoir suivre le fil de la lecture en comprenant exactement la démarche menée par le chercheur. De ce fait, la structure d’un article scientifique doit ressembler à celle-ci :
- Le résumé ;
- Les mots-clés ;
- L’introduction ;
- La méthodologie ;
- Les résultats ;
- La discussion ;
- La conclusion ;
- Les remerciements ;
- La bibliographie ;
- Les annexes.
De la première à la dernière partie, il est important d’aborder chaque élément de manière rigoureuse. Certaines de ces parties sont optionnelles, mais restent nécessaires. C’est le cas des remerciements ou encore des annexes par exemple. Toutefois, si le document contient de nombreuses photos, tableaux, et autres éléments graphiques, il est primordial de les insérer dans des annexes et non dans le corps du texte. Ceci étant dit, nous allons aborder la présentation d’un article scientifique
Tout c’est comme c’est le cas avec un livre ou encore un mémoire, la présentation de ce projet est normée. La police, le style, la typographie sont autant d’éléments à considérer lors de cette rédaction. Hormis cela, il existe 2 éléments qui facilitent la présentation des articles scientifiques. Il s’agit du résumé et des mots clés.
S’agissant du résumé, il a pour but de permettre au lecteur de comprendre assez vite l’objectif visé par l’article scientifique. À la simple lecture du résumé, le lecteur doit pouvoir se faire une idée assez claire des enjeux de l’article. Il est donc important de choisir avec soin les informations à intégrer dans cette partie. Elles doivent être pertinentes sans pour autant dévoiler les résultats des recherches menées. La présentation du résumé se fait sous forme de paragraphes, afin de faciliter la lecture. En général, le résumé doit occuper au maximum une page. Il est recommandé de l’écrire en français et en anglais.
En ce qui concerne les mots clés, il s’agit des termes et expressions qui facilitent le référencement de l’article en ligne. En d’autres termes, il s’agit de trouver des mots qui permettront au texte d’être le plus visible possible sur Internet. Le choix des mots clés ne se fait pas au hasard, et prend en compte le ou les domaines concernés par le projet. En général pour un article scientifique, l’on peut avoir jusqu’à 10 mots clés.
Comme vous le savez déjà, la structuration d’un article scientifique est extrêmement importante pour la compréhension de celui-ci. Pour le cas spécifique du corps du texte, il existe un acronyme qui résume bien les différentes parties et leur ordre de passage. Il s’agit de IMRAD qui signifie :
- I : Introduction
- M : Méthodologie
- R : Résultats
- A : And (et)
- D : Discussion
Cette structuration permet de mieux organiser le document, et surtout, elle facilite la cohésion entre les différentes parties. Vous pouvez suivre ces étapes pas à pas et voir leur application à travers un exemple d’article scientifique sur Internet.
L’introduction
Comme dans tout document écrit, l’introduction est extrêmement importante dans un article scientifique. Elle permet de planter le décor, et d’immerger le lecteur dans le contenu de l’article qu’il s’apprête à lire. Cette partie permet notamment de comprendre le bien fondé du texte. C’est pourquoi il faut présenter brièvement le cadre théorique autour du sujet abordé dans l’article. C’est le lieu de présenter les dernières découvertes liées au sujet d’étude. Ensuite, il est question de problématiser le sujet à travers une question claire. En général, il s’agit d’une question ouverte. À la suite de cette question, des hypothèses de recherche sont formulées. L’introduction représente environ 10% du volume global de l’article.
La méthodologie
De manière simple, la méthodologie permet de décrire le processus et les méthodes utilisées lors de la recherche. Elle représente environ 20% du contenu de l’article. Ainsi, le chercheur a la responsabilité de décrire précisément comment se sont faits l’échantillonnage, la collecte et l’analyse de données, etc. Selon le domaine d’étude, il est primordial de respecter scrupuleusement les méthodes conventionnelles tant lors de la collecte que lors de l’analyse des données. Le chercheur est d’ailleurs tenu d’expliquer chacun de ses choix, y compris le choix du site d’étude.
Les résultats
Comme son nom l’indique si bien, cette partie est prévue pour la présentation des différents résultats de l’étude. C’est l’une des parties les plus importantes de l’étude et des plus volumineuses aussi, car elle occupe environ 20% du texte. Pour une meilleure présentation, il est possible de subdiviser cette partie en plusieurs sous-parties. Le plus important est de garder la cohérence entre les différentes sous-parties. D’autre part, il est important d’utiliser des tableaux, des figures, des diagrammes pour faciliter la lecture et l’interprétation des résultats obtenus. Il est recommandé de présenter tous les résultats obtenus sans exception.
La discussion
Il s’agit de la partie la plus volumineuse, car elle est considérée comme le cœur de l’article scientifique. Elle occupe à peu près 40% du volume global du document. Dans cette partie, l’objectif est d’analyser de fond en comble les résultats obtenus. La discussion permet de ressortir de manière claire le point de vue du chercheur sur la question étudiée. Ainsi, il devra présenter chaque élément des résultats en y apportant une analyse et une interprétation propres à lui. Il est indispensable de relever que la discussion ne se fait pas en marge des données théoriques, bien au contraire ! À travers la discussion, le chercheur a la possibilité de confronter les connaissances existantes sur son sujet d’étude.
La conclusion
Tout comme l’introduction, elle représente environ 10% du contenu de l’article. Ici, le chercheur peut faire un bref rappel du cadre théorique en rapport avec le sujet étudié, avant de présenter sommairement les résultats obtenus. Une fois cela fait, il pourra confirmer ou alors infirmer les hypothèses de recherche énoncées à l’introduction. La conclusion peut s’achever par une ouverture de débat dans laquelle le chercheur propose une autre piste d’étude en fonction des limites du sujet qu’il a abordé.
Les remerciements
C’est une partie facultative, mais très importante. Il est difficile de terminer un travail sans bénéficier du soutien de quelques personnes (collègues, mentor, institutions, etc.). Cette partie est donc prévue pour montrer de la gratitude aux personnes qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à la réalisation du projet.
La bibliographie
« Il n’y a rien de nouveau sous le soleil » dit-on ! À la fin d’un article scientifique, il est toujours important de citer les différentes sources qui ont été utilisées à un moment donné. Le chercheur a l’obligation d’intégrer à la fois les sources bibliographiques des auteurs cités dans le texte, et même des sources qui n’ont pas été citées, mais qui ont été exploitées lors de la réalisation du document. La manière de présenter les différentes sources bibliographiques obéit à une structure précise, selon le domaine d’étude.
Les annexes
En général, il s’agit de la dernière partie d’un projet. Elle intègre notamment des photos, des tableaux, des diagrammes et autres éléments qui n’ont pas pu être insérés dans le corps de l’article.
La construction du plan d’un article scientifique ne se fait pas au hasard. Il existe en effet de nombreux aspects à prendre en considération.
Le premier aspect à prendre en compte, c’est le choix de la revue à réaliser. Il est nécessaire de définir de manière claire la cible que l’on veut atteindre. Il faut ne pas perdre de vue que l’un des objectifs majeurs de ce projet, c’est de partager ses connaissances avec ses pairs ou encore des passionnés d’un domaine particulier. Le choix de la revue à réaliser est donc crucial.
Ensuite, il faut faire une mise à jour de la documentation relative au sujet choisi. La rédaction d’un article scientifique repose en grande partie sur la bibliographie existante en rapport avec le sujet étudié. Le chercheur doit donc explorer de manière non exhaustive les ouvrages qui abordent sa thématique sous un angle ou un autre. Toutefois, il est recommandé de privilégier les sources ou encore les recherches les plus récentes.
Un autre élément à considérer, c’est l’innovation qu’apporte l’article à rédiger. Il ne sert à rien d’écrire un article scientifique qui n’apporte aucune nouvelle donnée en rapport avec le sujet étudié. Et donc, l’auteur doit pouvoir se poser la question suivante : en quoi mes recherches apportent-elles un plus aux connaissances existantes ?
Une fois que tout cela est fait, le chercheur n’a plus qu’à présenter le plan de son travail, en s’assurant d’établir un lien, une connexion entre les différentes parties.
Savoir comment rédiger un article scientifique de A à Z demande un gros investissement du chercheur, à la fois sur le plan financier, énergétique, etc. Et pour y arriver, voici quelques conseils :
- Faire une bonne recherche bibliographique : presque tous les travaux ne se réalisent pas ex nihilo (à partir de rien). Au contraire, le chercheur doit s’inspirer de la documentation existante et de ses limites, afin de réaliser une étude pertinente et digne d’intérêt.
- Faire une évaluation des ressources à mobiliser : la rédaction d’un article scientifique demande du temps, de l’énergie, de l’argent, du matériel, et bien d’autres. Il est important de s’assurer de la disponibilité de ces différentes ressources au risque de se trouver buté en cours de route. Alors, ne négligez aucun aspect au moment de faire l’évaluation des ressources à mobiliser.
- Être rigoureux et organisé : la rédaction demande beaucoup de méticulosité. Il est donc important d’être rigoureux dans la manière d’obtenir et de traiter les informations.
Soigner la forme : au-delà du fond, la forme est un aspect majeur. La mise en page d’un article scientifique par exemple peut donner envie au lecteur de le lire ou pas. Il est également important de faire relire le texte par des professionnels, afin d’éliminer toutes les fautes que pourrait contenir le document.